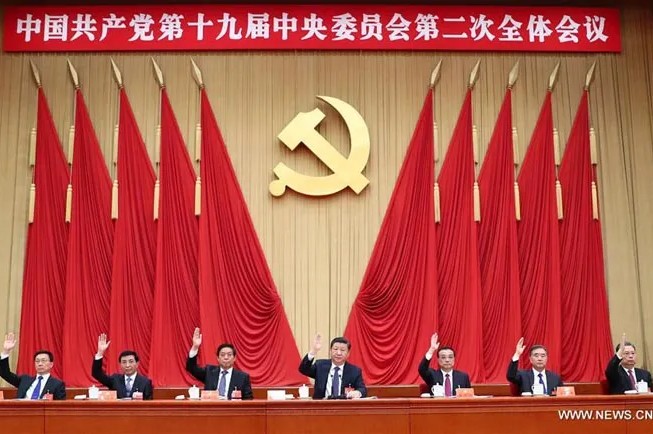RFI : Dans un récent article paru sur le site Asialyst, vous pointiez la rareté des « résolutions historiques », telle celle attendue lors de la session plénière du comité central du parti réuni cette semaine à Pékin. A quoi servent ces « résolutions » ?
Pour le Parti communiste chinois, ces résolutions historiques 历史决议 sont des changements importants qui affectent les fondements du régime. Il s’agit d’inaugurer une « nouvelle ère » – en construisant sur la légitimité du « régime précédent ». C’était le cas en 1945, lors du 7e Plénum du 6e Congrès, comme en 1981 lors du 6e Plénum du 11e Congrès. La première résolution « sur certaines questions/problématiques historiques du Parti » visait à souligner les erreurs de dirigeants communistes opposés à Mao, ainsi qu’à souligner la contribution du leadership de Mao à la pensée marxiste-léniniste, mais aussi à la révolution. En ce sens, la première résolution vient confirmer la position de Mao en tant que leader du Parti après le mouvement de rectification de Yan’an qui aura également servi de purge et la « victoire » des communistes contre les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. C’est, en ce sens, le début de l’ère Mao en tant que leader suprême du Parti. La seconde résolution [sur certains problèmes historiques du Parti depuis la fondation de la République populaire] intervient en 1981, alors que les forces de Deng Xiaoping et des réformateurs reviennent au gouvernement central après avoir été purgées durant la révolution culturelle. La résolution visait alors à séparer l’héritage communiste des excès de la gauche, et en particulier de la Révolution culturelle. Les réformateurs se devaient d’« évaluer » l’héritage de Mao ainsi que ses possibles « erreurs » avant de pouvoir avancer. Cela dit, l’objectif réel était d’avoir, au sein du Parti, une discussion sur les erreurs du leader et d’avertir les derniers alliés de Mao, alors encore en poste dans la structure du Parti-État, que la Chine allait prendre une nouvelle direction, sans révolution permanente et donc dans l’esprit des réformateurs. Cela étant dit, Deng Xiaoping marchait sur des œufs. Il a indiqué que la révolution culturelle avait été lancée à tort par Mao, mais ensuite utilisée par des groupes contre-révolutionnaires pour faire du tort au Parti. Impossible de renier Mao, sans renier la légitimité du Parti.
Les deux premières « résolutions » sont intervenues à une période de crise au sein de l’appareil, qu’en est-il aujourd’hui ?
On note d’abord que c’est une résolution qui arrive tardivement. Faut-il considérer la période 2017-2021 comme une période de crise ? On aurait pu penser que Xi aurait tenté de faire passer la résolution en 2017, afin de garder une équidistance de trente-six ans comme pour les deux autres résolutions. Ce qui est certain, c’est que Xi Jinping doit également faire le point sur l’expérience des réformes des quarante dernières années. Comme Deng Xiaoping a dû revenir sur le Grand bond en avant et la révolution culturelle de Mao, Xi Jinping doit se retourner sur les événements de 1989. Problème : revenir sur 1989 serait opposer à un discours portant sur l’unification du leadership et ferait ressortir les divisions idéologiques qui subsistent à l’intérieur du Parti, mais aussi, les divisions qui existent entre le Parti et la société chinoise. En ce sens, cela mettrait à plat tous les efforts d’unification du Parti et les discours portant sur la « nouvelle ère » de développement. Cette troisième résolution risque ainsi d’être confrontée aux mêmes problèmes que les deux premières, en ce sens que cela oblige à parler des réussites et des erreurs du Parti sous l’ère Deng Xiaoping.
La grande question est donc de savoir ce que pense le Parti sur le sujet en termes de réussite et d’échec. Les grands accomplissements, ce sont probablement la politique de réformes et d’ouverture et la mise de côté de la révolution au profit de la gouvernance. Pour les erreurs, c’est plus délicat. (Et) que dire du 4 juin 1989 ? Peut-on éviter d’en parler ? Les deux options sont risquées pour le leadership actuel. C’est très complexe, car si par exemple on met la corruption et les écarts de richesses sur le dos des réformes issues de la 2e résolution, alors les quatre dernières décennies en seront discréditées, tout comme le Parti d’ailleurs. En ce sens, Xi Jinping devrait à la fois « applaudir » les réformes, mais dire que les excès ne viennent pas du leadership de ses prédécesseurs, ce qui lui permettrait de promettre de compléter le travail accompli lors de la prochaine « ère ». En ce sens, les « résolutions historiques » sont non seulement techniques, mais toujours très polémiques au sein du parti.
À quoi sert cette troisième « résolution historique » pour Xi Jinping ?
C’est une façon complexe de se hisser au sommet des luttes intestines afin de pouvoir mettre en place sa vision du Parti, du retour aux sources, du retour vers le dirigisme, sans avoir à encore être lié aux contraintes de l’ère Deng Xiaoping. Pour le Parti, c’est à la fois un regard en arrière, mais aussi vers l’avant. C’est donc difficile et il est possible qu’une tentative soit faite durant le sixième plénum, mais qu’il soit nécessaire d’attendre l’année prochaine pour que la résolution soit adoptée – compte tenu de la gymnastique linguistique nécessaire – lorsque le Comité central pourra s’entendre sur quoi dire des événements de 1981 à 1991. Sans quoi, le Parti risque la cassure, tant dans son ensemble qu’avec la société chinoise.
Source: RFI